¶ Géographie et climat
Situé au Sud-Ouest du Royaume de Monteleonne et ainsi enclavé par la mer de Saranna et l’océan glacial, l’Empire de Hennequince se constitue tel qu'une vaste étendue de terres rendues infertiles par le froid accablant y demeurant.
Si les continents frontaliers profitent quant-à eux de divers climats ; l’Empire de Hennequince se voit pour sa part entièrement écrasé sous les conditions climatiques arides que leur impose une position aussi excentrée du continent.
L’horizon hennequin se veut pâré de hautes chaînes de montagnes de givre contenant bien largement les diverses terres composant l’empire. Les diverses cités se sont ainsi vainement érigées à même les plateaux de l’Empire, s’échinant alors à arborer leurs alentours de cultures tout au plus artificielles ainsi galvanisées par la dotation dépendant ici de l’oeuvre des hommes ; en conséquence de l’aridité des terres gagnées par un climat tout au plus glacial.
En marge de certaines cités, l’on retrouve parfois de modestes pan de bois se mourrant progressivement, se répandant incessamment ; pareil à une épidémie gagnant un peuple harassé par la gangrène.
Au delà du continent, l’Empire de Hennequince possède depuis moins d’un siècle l’île marécageuse de la Nébuleuse, à la frontière entre la principauté de Gaçaferi et le Royaume de Monteleone, au climat plus chaleureux que le reste de l’Empire malgré sa maigre superficie.
¶ Histoire
¶ Un royaume parmi tant d’autres
Les origines du royaume de Hennequince se sont perdues dans les limbes du temps. C’est à partir de 302 que le pouvoir se structure autour d’un roi (dont le nom est inconnu) sur ce continent bientôt divisé en quatre royaumes. Ainsi l’on retrouve au sud-est du continent la principauté des Angoutois partageant ses frontières avec le royaume de Limart à l’Ouest. Les premières chroniques mentionnent un développement économique sans précédent et des tensions avec le royaume de Valenrgue, au nord, dès les années 390. C’est à l’occasion de la guerre contre son voisin septentrional que le royaume de Hennequince apparaît dans de plus en plus d’écrits, montrant une volonté pour le pouvoir de légitimer son combat et d’apparaître dans l’Histoire.
Valenrgue, petite cité installée sur un carrefour routier, est petit-à-petit devenue le repaire de plusieurs bandes de tire-laines et autres détrousseurs profitant de la situation géographique pour soulager les marchands itinérants de quelques biens ou pièces. La situation échappe lentement au seigneur local et complique grandement les échanges entre les royaumes de Hennequince et de Valenrgue. Pressé par une faction belliciste de plus en plus insistante, le roi de Hennequince se décide de monter son ost et de pallier à l’incapacité de son homologue de faire régner la tranquillité. En fait, sous couvert de chasser les brigands, Albéric II a trouvé le casus belli nécessaire à la réalisation de ses aspirations politiques : agrandir le territoire du royaume de Hennequince - d’autant plus qu’il doit alors affronter une contestation larvée émanant de certains de ses conseillers. L’ost d’Albéric II écrase facilement les quelques troupes hâtivement levées par Valenrgue, et le royaume se délite en l’espace de quelques affrontements. En 405, le royaume de Hennequince double donc sa superficie, et ce à moindre coût ; la quasi-élimination du brigandage attire à nouveau les commerçants et permet à Albéric II de renforcer sa légitimité.
Mais l’annexion rapide de Valenrgue a prouvé aux autres royaumes du continent que Hennequince peut être un danger. Surtout, cette victoire facile et rapide a donné des idées à de nombreux nobles de la cour du roi Albéric II : pourquoi s’arrêter à Valenrgue alors que le reste du continent est lui aussi prospère ? Au fil des ans, cette position gagnera des partisans, alors qu’au même moment le roi de Limart, au sud-est du pays, se méfie de l’appétit de son voisin.
¶ La marche inéluctable vers l’Empire
L’an 451 marque l’aggravation des tensions entre les royaumes de Hennequince et de Limart. Le second n’a jamais été satisfait de l’expansionnisme de son voisin mais n’a jamais été en mesure de le défier sur son propre terrain. S’ouvre alors un conflit larvé entre Hennequince et Limart, démarrant par des coups bas : certains marchands hennequins voient leurs commandes annulées, tandis que plusieurs criminels s’évadent de la prison de Barjac et se dirigent tout naturellement, sans être rattrapés, vers le territoire limartin. Les tensions vont aller en s’aggravant, mais les deux royaumes ne prendront jamais le risque de se livrer à une confrontation directe : Limart n’en a pas les moyens, et Hennequince a vu sa faction belliciste perdre énormément d’influence à la suite d’un scandale de mœurs.
Ce n’est qu’en 461 qu’un événement détourne les deux rivaux l’un de l’autre : une prolifération soudaine de Lamoiseaux au sud du royaume de Hennequince vient causer la mort de nombreux paysans. Au fil des jours, ces rapaces sèment la destruction à travers la région, tuant bétail, marchands, ainsi que simples citoyens vaquant à leurs occupations. Très vite, les Lamoiseaux se déplacent, franchissent la frontière de Limart et ravagent les territoires du royaume. Devant cette menace qui pèse sur leur économie, les deux royaumes sont bien obligés de réfléchir pour remédier au problème… en se focalisant un peu moins sur leur voisin.
Un matin de l’an 478, les dotés de la région de Valenrgue se réveillent après avoir fait une vision : le temple de Valenrgue avec, devant lui, une pile de cadavres. Interloqués par cette vision commune, les dotés décident ainsi naturellement de se réunir. Tous arrivent à la même conclusion : il faut se diriger vers le temple de Valenrgue car une sombre menace plane sur les environs. On note une affluence de dotés, par petits groupes ou seuls, dans la ville - et ce dès l’hiver, traditionnellement moins propice aux arrivées de voyageurs. Cependant, les diverses autorités de la ville ne leur accordent qu’une oreille distraite, ne voyant aucun signe funeste dans ce que les hiérarques appellent alors un simple songe. Jusqu’en 483, les dotés vont tout faire pour tenter de rallier à leur cause hommes politiques, dirigeants et nobles de Valenrgue, sans succès. Leur insistance est telle qu’ils s’attirent les foudres du clergé et que la délégation doit quitter l’enceinte de la cité. Par peur d’autres réactions et convaincus qu’un malheur sans nom va s’abattre sur la ville, les dotés décident de se reclure dans les monts valenvin, se préparant à un hypothétique désastre.
Trois ans plus tard, alors que l’épisode est presque oublié à Valenrgue, le roi Léandre de la dynastie Lescharames-Mantauvard reçoit des rapports inquiétants des provinces orientales de son royaume. Depuis quelques semaines, plusieurs familles entières ont perdu la vie à cause d’un mal inconnu : les symptômes s’avèrent terrifiants. Fièvre, diarrhées, vomissements… suivis de la mort en l’espace de quelques jours. Aucun traitement ne semble soulager les malades, tandis que le nombre de contaminés grimpe en flèche. Les savants désoeuvrés devant cette progression rapide et la virulence des symptômes décident de nommer la maladie « choléra ».
D’abord ignorée par le roi Léandre, la maladie se répand comme une traînée de poudre à travers le royaume - et traverse même les frontières. Des foyers épidémiques apparaissent dans le royaume de Limart, mais aussi dans la principauté des Angoutois ; femmes, hommes et enfants meurent par centaines, souvent au milieu des rues dont les rigoles d’évacuation sont souillées. Une psychose s’empare de la population, mais la recherche de boucs émissaires et leur élimination n’arrange rien. La maladie décroît cependant dès le printemps 487… avant de flamber à nouveau lors de l’hiver suivant. Pendant encore deux ans les royaumes du continent seront frappés par des vagues épidémiques plus ou moins violentes, qui feront vaciller les institutions et suspendront les échanges commerciaux avec le continent durant près d’un millénaire. C’est d’ailleurs cette opportunité que saisit le roi Léandre en 491 pour envahir et annexer le royaume de Limart sous prétexte de prévenir de graves troubles en préparation. En fait, Léandre a vite compris que son rival n’avait pas su se relever après l’épidémie de choléra et qu’une telle occasion ne se représenterait jamais.
Commence alors une période de véritable rémission pour le royaume de Hennequince. Encore fragilisé par l’épidémie, il parvient cependant à se relancer avec l’absorption du royaume de Limart aux ressources naturelles conséquentes et sous-exploitées. Le redressement sera toutefois long, avec des familles entières fauchées et des terrains à réassigner. Le roi Léandre en profite pour redécouper les terres arables et à les confier à des grands entrepreneurs, dans l’optique de décupler la productivité et de redonner aux marchands des biens à échanger.
Cependant, en 571, un différend territorial avec la principauté des Angoutois mène le royaume de Hennequince à lancer une série d’escarmouches sur le territoire du dernier royaume indépendant du continent. Mais, au contraire des dirigeants de Limart, ceux de la principauté sont portés sur la chose militaire et n’hésitent pas à répliquer, menant une véritable guérilla qui inflige de lourdes pertes aux assaillants. Il faudra attendre 572 pour que les deux royaumes signent un traité de paix ramenant au statu quo ante et qui porte donc les germes d’un futur conflit.
Le siècle à venir est placé sous le signe du développement économique pour Hennequince, qui profite des ressources de l’ancienne province de Limart pour développer tout un pan de son artisanat. De nombreux bâtiments ouvragés en pierre sortent de terre, et les villes en profitent pour se ceindre de murailles - voire de les réparer et de les améliorer, les récents raids angoutois ayant prouvé aux bourgeois que la sécurité n’était jamais quelque chose d’acquise trop longtemps.
Il faudra attendre 691 pour que la guerre se ravive entre le royaume de Hennequince et la principauté des Angoutois. Au cours d’une campagne éclair (lors de laquelle les troupes angoutoises sont annihilées dans plusieurs embuscades), toute la partie occidentale du pays tombe aux mains des troupes hennequines. Seule l’arrivée de la mauvaise saison et l'allongement des lignes de communication pousse le roi de Hennequince à proposer une paix que le prince angoutois s’empresse d’accepter. À partir de 692, le continent de Hennequince est quasiment entièrement mis sous coupe réglée par Chasteau-Levallac, et le destin du reste de la principauté des Angoutois semble scellé. Au grand étonnement des chroniqueurs du royaume, le siècle à venir ne va amener aucun conflit, d’autant plus que des pluies torrentielles amènent des inondations sévères en 757. De nombreuses cités construites autour des fleuves sont inondées, les champs détrempés, et des dizaines de milliers de villageois doivent se réfugier sur les hauteurs. L’eau mettra presque six mois à se retirer entièrement, ruinant entièrement la récolte et obligeant à réaliser de lourds travaux aux quatre coins du pays. Le royaume mettra plusieurs décennies à s’en remettre, obligeant le pouvoir à se consacrer entièrement aux affaires internes et non plus à ses frontières - qui, de toute façon, sont sûres au vu de la faiblesse de l’adversaire potentiel.
Il faudra attendre l’an 890 pour que le roi Marcival, qu’on dit très ambitieux, décide d’annexer une fois pour toute la principauté des Angoutois et d’unifier le continent sous une seule et même bannière. Son adversaire n’est pas en mesure de vaincre au vu de la disproportion des forces, mais la pacification de la province durera près de deux ans avec de nombreuses exactions menées par les troupes hennequines. En 892, le dernier bastion angoutois au sud du pays tombe, le roi Marcival y installant une garnison permanente afin de prévenir tout risque de rébellion future. L’année marque alors un tournant avec l’unification du continent, la disparition de la monarchie… et la naissance de l’Empire de Hennequince.
¶ Le colosse aux pieds d’argile
La paix à peine retrouvée au cœur de l’Empire récemment établi, une dévastatrice famine vient soudainement faire trembler la population en l’an 1310. N’ayant profité d’une saison suffisamment douce, les récoltes se voient relativement mauvaises, précipitant ainsi l’inévitable disette. Les diverses maisonnées les plus aisées spéculent sur les quelques maigres quantités de céréales, faisant ainsi considérablement grimper leur prix. Tandis que la population s’affame, quelques foyers de contestation s’allument au travers des régions condamnant et/ou réduisant le recours à la dotation, ne permettant par conséquent de galvaniser les cultures afin de pouvoir subvenir aux besoins primaires de celle-ci.
C’est alors sous les conseils avisés de sibylles que le Podestat Bruno autorise qu’une poignée de dotés puisse suppléer le Sénat dans son œuvre afin d’apaiser les tensions s’intensifiant en confiant pain et denrées au peuple en souffrance.
Dorénavant davantage disposées à encourager ou simplement à avoir recours à la dotation afin d'accroître le fruit des récoltes hennequines, certaines régions du continent se voient attribuer une place particulière aux dotés afin d’augmenter de manière significative la qualité de vie de leur population. D’autres régions à l’est quant-à elles demeureront prudentes voire opposées à l’utilisation de ce phénomène encore peu connu, craignant que cela n’ait un impact néfaste à long terme sur le continent.
C’est ainsi en l’an 1392 que se tient un fastueux jubilé afin de célébrer le 500ème anniversaire de l’Empire de Hennequince, les célébrations s’étendant généreusement sur l’année entière au travers de moult festins.
L’an 1440 est marqué par de grands quoique brefs bouleversements. En effet, le Podestat Walcaud dont le goût prononcé pour les liaisons extra-conjugales est bien largement reconnu, se voit être assassiné en ses appartements personnels par l’un de ses proches courtisans dont il s’approprie les faveurs de son épouse. Troublé par la violence et la brusquerie de cet évènement, l’Empire de Hennequince se voit temporairement déchiré par la panique s’immisçant en ses sphères politiques. Alors que l’assassin de feu le Podestat Walcaud est en passe de se faire juger, le sénat s’attribue progressivement le contrôle des cités hennequines en s’insinuant parmi les courtisans et sénateurs remettant en question la capacité de gouverner du Podestat. Si le gouvernement en place connut une brève baisse de popularité, une faction du sénat ne tarda plus à appuyer la nécessité de conserver le Podestat en affichant insidieusement que l’armée hennequine demeurait à ses côtés. C’est au terme de deux à trois semaines que l’on parvint à rétablir l’ordre initial, les derniers sénateurs contestataires étant contraints à l’apaisement. Ainsi s’éteignirent les ondes de confusion tandis que l’assassin du Podestat se voyait enfin exécuté.
L’Empire de Hennequince fut sollicité en l’an 1514 par les grands royaumes centraux, avec lesquels il s’était appliqué à maintenir une certaine distance depuis le funeste épisode de choléra ayant suspendu leur commerce commun. Désormais impliqués dans le conflit majeur du XVIᵉ siècle que constitue la Basse-Guerre, les deux belligérants ne tardèrent pas à lever des fonds considérables afin de financer les affrontements à venir.
Cette sollicitation marque la première réouverture notable des relations commerciales et politiques entre l’Empire hennequin et le continent central, amorçant ainsi la sortie progressive d’une autarcie entamée à la fin du Vᵉ siècle. Ce rapprochement aboutit, plusieurs décennies plus tard, à l’acquisition de l’île de la Nébuleuse.
Anciennement montelan, ce territoire fut cédé par le Royaume de Monteleone afin de recouvrer les dettes contractées au terme de la Basse-Guerre, dans le cadre d’un contrat de non-agression stipulant notamment l’interdiction faite à l’Empire hennequin d’y ériger toute structure défensive d’envergure.
¶ Situation politique
Bien au large du continent connu, l’immense île qu’incarne l’Empire d’Hennequince l’isole en grande partie des conflits qui martèlent Septentrion. Jouissant d’une position particulièrement propice à la neutralité, l’État hennequin ne s’investit que rarement dans les affaires des autres nations, sinon par l’entremise de ses banques impériales, lesquelles financent parfois les grandes guerres lorsque les établissements farhésiens ne sont plus en mesure de le faire.
Ce n’est toutefois qu’en l’an 1602 que le Royaume de Monteleone, acculé par les dettes contractées pour financer la Basse-Guerre et menacé par une famine grandissante, consent à céder à l’Empire de Hennequince une parcelle de ses terres. L’Empire se voit alors reconnaître la possession de l’île de la Nébuleuse, nommée Talioferra.
Il règne, à cette époque, une paix relative sur les terres hennequines, seulement troublée à intervalles irréguliers par diverses intrigues politiques et manœuvres diplomatiques.
¶ Population
L’Empire de Hennequince dispose d’une population conséquente essentiellement composée de roturiers. Si la noblesse y est plus ou moins bien représentée, celle-ci se concentre majoritairement en la capitale de Chasteau-Levallac tandis que bourgeoisie et noblesse d’affaires trouvent place en périphérie de celle-ci.
Récemment impliqués en les échanges commerciaux du continent central, l’on peut y constater une faible croissance des flux migratoires.
Les habitants de l’Empire de Hennequince, appelés Hennequins, possèdent généralement une peau claire à légèrement rosée, héritée des climats froids et tempérés de leurs terres. Dans les grands ports du nord, il n’est pas rare de croiser des hommes et des femmes à la peau noire, descendants de marins ou de voyageurs venus d’outre-mer. Leurs cheveux sont variés : blonds cendrés, châtains et roux étant les plus répandus, souvent portés longs chez les femmes, parfois nattés, et courts ou mi-longs chez les hommes, souvent avec des mèches effilées. Les yeux varient entre le bleu glacier, le vert pâle et le brun noisette.
Les Hennequins arborent des habits pratiques, souvent faits de laine ou de lin épais, dans des teintes neutres comme le gris, le brun, le vert, le jaune et parfois relevés de broderies beigeâtres ou argentées. Les bijoux, lorsqu’ils en portent, sont sobres et forgés en cuivre ou en argent, souvent ornés de motifs celtiques ou naturalistes. Certains habitants, en particulier les dotés, osent encore porter les tatouages des dieux du panthéon, discrètement gravés dans leur chair, comme des murmures d’un passé toujours présent.
¶ Armée
En paix depuis plusieurs siècles, sans jamais avoir été envahi, l’empire de Hennequince n’a pas vocation à maintenir en état une armée conséquente. Chaque région dispose d’une garnison attitrée constituée de plusieurs régiments de fantassins de métier recrutés parmi la population locale. Si, en théorie, ces troupes devraient être disponibles en cas de conflit, la réalité est toute autre : les régiments au sud de l’empire sont nettement moins bien entraînés que ceux situés sur la côté nord-est. Selon les derniers recensements, ces régiments représentent environ 10 000 hommes, dont seulement les deux tiers auraient une valeur combattive suffisante.
Une unité de cavalerie lourde (dont les soldats sont nommés « cavaliers de la Courtine », leur caserne étant adossée à la muraille) est stationnée en permanence dans la capitale, à Chasteau-Levallac, et fait office de véritable garde impériale. À chacun de ses déplacements hors des murs, le Podestat est escorté par un détachement de cavaliers chargés de sa sécurité. Cependant, n’ayant jamais vu le combat, les cavaliers de la Courtine sont davantage des fils de belle famille pas assez doués pour les affaires ou la politique qu’on décide de mettre à l’ombre. Divisée en trois cohortes, l’unité dispose d’un système d’identification basé sur la couleur : le pourpre pour la première cohorte, l’ocre pour la seconde et le vert pour la troisième. Durant leur service (qui s’étale sur 7 ans), les cavaliers apprennent le maniement de la lance mais aussi l’escrime ; depuis quelques décennies, le Podestat a décidé de renforcer les capacités de ces soldats en requérant les services de maîtres d’armes réputés.
L’empire de Hennequince dispose cependant d’une armée non négligeable et sans équivalent au sein des autres royaumes, nommée la Compagnie de Fer. Composée de 500 hommes, cette unité a été instituée à la fin du XVIe siècle à grands frais par le Podestat Magnéric suite à l’acquisition de plans pour la fabrication d’arquebuses à mèche. Excessivement chère à produire et très difficile à utiliser, l’arquebuse a néanmoins un fort impact au combat face à des soldats qui ne sont pas habitués à ses effets. Les soldats sont équipés d’une cuirasse (d’où provient leur surnom) et paradent à chaque début de saison dans l’enceinte de la capitale. S’ils n’ont jamais été employés au combat, leur potentiel offensif impressionne grandement les étrangers.
Enfin, l’ouverture de l’empire sur le monde amène les Podestats successifs à envisager la mise sur pied d’une flotte de guerre conséquente ; cependant, faute de direction préalablement définie, le projet est au point mort de nos jours.
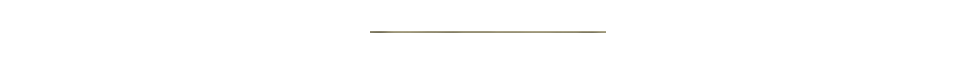
Localités principales
Liens annexes
Armoiries
