Chasteau-Levallac

Marquant l’horizon de par ses hautes fortifications, la capitale hennequine se démarque par sa constitution étoilée la rendant quasiment impénétrable. Apposée aux abords du fleuve de l’Angoutoise, un canal fut créé pour entourer les épaisses murailles de la cité; le canal de Drenguilly. Fondée en 387 comme premier pied-à-terre des colons qui formeront plus tard le premier Conclave des Victorieux, la cité s’est lentement développée en faisant usage parcimonieux des ressources des alentours. Adoptant une fortification bastionnée plutôt que de nombreuses murailles, les architectes de la ville optèrent pour des défenses plus réfléchis, au dépit de l’expansion d’une ville au sein des murs. Ainsi, le centre de la cité, autrefois la ville entière, abrite les citoyens les plus privilégiés tandis qu’une immense banlieue s’est formée au pied des défenses de Chasteau-Levallac, constituant presque une seconde ville que l’on nomme populairement “Petit-Levallac”.
¶ Hors des murs
Massées en d’étroites ruelles grouillant de vie, les habitations du Petit-Levallac marquent un sinistre regroupement de pierraille sombre et de chaux. Bruyant et en mouvement constant, le quartier s’est développé en périphérie de la vieille ville et n’est donc régi par aucune loi d’aménagement, offrant alors au visiteur inexpérimenté de nombreuses impasses. Sommairement pavées, les rues du quartier sont sinueuses et ornées de nombreuses échoppes de tanneurs, apothicaires, herboristes, bouchers et autres artisans, incarnant un véritable pôle commercial en dehors de la ville.
L’on dit que les quelques cultures prospérant sur les pourtours de la capitale sauraient ici être fructueuses par un régulier recours à la dotation quant-à la fertilisation des terres.
Dans les bas-fonds de Petit-Levallac, là où les ruelles s’entrelacent en un labyrinthe de misère, s’est maintenant dressé un camp misérable, un amas de toiles déchirées et de planches branlantes où s’entassent les réfugiés fuyant l’horreur montroissanne et saulignoise. Ils arrivent par vagues, exténués, hâves, traînant derrière eux leurs derniers biens ficelés dans des ballots crasseux. Beaucoup sont blessés : des corps amaigris striés de plaies, des bras en écharpe, des jambes aux chairs violacées où suppurent les blessures mal pansées.
L’air est épais d’une puanteur de sueur, de sang et de fièvre. Ici, on gémit, on pleure, on agonise dans la boue. Les enfants, petits spectres faméliques, errent pieds nus entre les abris, leurs ventres creux gonflés par la faim, agrippant les jupes de mères malingres dont les yeux éteints ne versent plus de larmes. Les hommes, eux, brisés, assis contre les murs noircis, fixent le vide, des haillons de fortune cachant à peine leur honte et leur détresse.
Et partout, la maladie rôde, s’immisce entre les corps serrés, fauche ceux que la marche infernale n’a pas déjà pris. Dans ce cloaque de désespoir, quelques âmes charitables tentent d’apporter un semblant de répit : une vieille femme nettoie les plaies d’un moribond, un gamin court mendier du pain aux portes des quartiers plus riches. Mais Chasteau-Levallac détourne le regard. Ici, on survit en silence, en priant que la mort vienne vite ou que, par quelque miracle, la cité daigne enfin leur tendre la main.
¶ Quais de la Charyonne
Pateaugeant dans les berges du fleuve de l’Angoutoise, le port de la Charyonne agit comme le principal lieu de commerce de la cité, aux côtés du Petit-Levallac. Essentiellement dédié à la marchandise, le port ne contient qu’un petit chantier naval destiné surtout à l’entretien des navires commerciaux et non pas à la construction de navires de guerre. Le long des quais, d’innombrables marchés de poissons ou de denrées venant des autres régions de l’empire se tiennent, attirant bon nombre de la population, illustres ou rustres. En raison de la densité de la foule qui s’active journalièrement au sein du port, la Charyonne est gardée par de fréquentes patrouilles de gardes, délaissant alors peu de chances aux crimes autres que de simple vols à l’étalage.
¶ Chemin des Pigeons
Baptisé en raison des innombrables oiseaux qui envahissent les rues longues du quartier, le Chemin des Pigeons est une zone englobant le tour de la disposition bastionnée de la ville, établie au sein de la première couche de “l’étoile” que forme Chasteau-Levallac. Éclectique et vigoureux, le quartier est principalement composé des habitations des alleutiers et bourgeois de la cité qui se démarquent par leur hauteur et leurs balcons. En effet, afin de rentabiliser la place réduite qu’offre la constitution de la ville, les habitations sont massées en grands bâtiments comportant deux à trois appartements capables de loger plusieurs familles. De nombreux commerces parsèment également les rues, généralement placés au rez-de-chaussée, sous les bâtiments. Ainsi, on y retrouve tous les tailleurs, menuisiers, forgerons, apothicaires et autres artisans au sein des murs, absents de la Voie des Cèdres. Pavé et peu propre, le Chemin des Pigeons est saccagé des déchets de ses habitants qui ne disposent d’aucun canal pour acheminer leurs ordures. C’est alors aux esclaves de la ville de, plusieurs fois par semaine, débarrasser les rues des détritus afin de libérer le passage et de chasser les rats ou autres nuisibles.
¶ Voie des Cèdres
S’étendant au sein de la deuxième couche de fortifications de Chasteau-Levallac, la voie des Cèdres est un petit quartier en longueur qui mène jusqu’aux portes des Allées Impériales. Restreint de par sa taille et ses fréquentations, le quartier est uniquement comblé des manoirs des notables levans ainsi que d’extrêmement rares échoppes de produits de luxe tels que marchands d’épices et orfèvres. Entièrement pavée et dénuée des ordures qui sont jetées plus bas dans le Chemin des Pigeons, la Voie des Cèdres porte ce nom en raison de ses longues allées d’arbres qui viennent contraster la grisaille et les imposants bâtiments qui l’ornent. En raison des moeurs assez sages des hennequins, le quartier n’est point fermé au publics comme le sont les hauts-quartiers continentaux. On préfère l’assurer en y déployant d’épaisses troupes de gardes afin de laisser serfs et esclaves l’arpenter en quête de travail auprès des illustres.
¶ Allées Impériales
Minuscule quartier surmontant Chasteau-Levallac, les Allées impériales se logent au centre de la cité parmi la dernière couche de fortification. Ornementales, les rues ne comportent qu’une poignée de manoirs de quelques officiels impériaux. Le reste du quartier se compose de parcs et de jardins parfaitement entretenus et décorés des statues de membres notables de la famille impériale. Au fond du quartier se dresse la gigantesque Forteresse de l’Argennin, bastion de la famille impériale et de sa cour et siège du gouvernement hennequin. Décoré d’innombrables arches et vitraux et gardé par de nombreuses gargouilles de pierraille sombre, l’édifice est composé de nombreuses ailes et de cours et jardins intérieurs. En raison de l’espace limité, le palais adopte la même constitution que le reste de la ville et s’élève à plus de six étages, abritant les membres les plus illustres de l’empire. Gardées par de hauts murs et d’innombrables gardes, les Allées Impériales demeurent le seul espace de Chasteau-Levallac fermé au public et auquel l’accès est réservé aux gens disposant d’une autorisation de passage.
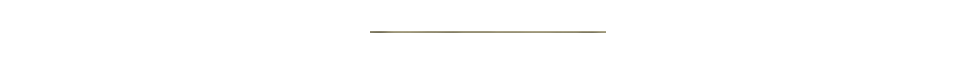
¶ Économie
¶ Commerce
Chasteau-Levallac est une cité où le commerce demeure florissant en raison du nombre conséquent d’habitants et de son statut de capitale. Sa position le longs des berges de l’Angoutoise offre à la ville de bonnes ressources en poisson et perles, souvent échangée avec les villes hennequines se situant sur des plateaux loin de grands cours d’eau. Cependant, l’absence de cultures importantes autour de la cité crée une dépendance à l’import de marchandises telles que le grain ou les denrées animales. Ainsi, la cité agit en tant que point d’échange de toutes les cités hennequines.
¶ Artisanat
L’artisanat levan est le plus développé des villes hennequines. En effet, la capitale regroupe le plus grand nombre d’artisans diversifiés de l’empire et jouit d’un commerce profitable, délaissant moult travail. La culture et le travail des perles est une particularité qu’a Chasteau-Levallac, où les joailliers et orfèvres produisent bon nombre d’oeuvres qui en usent.
¶ Richesse locale
Chasteau-Levallac demeure la cité la plus aisée de l’empire d’Hennequince et bastion de la famille impériale. Ainsi, les dirigeants aspirent à ce que la ville garde ce statut qui leur est profitable en raison des taxes. Le développement incessant du commerce de la cité lui offre une économie florissante qui contribue à l’amas des richesses.
¶ Société
¶ Criminalité
Bien que comportant une population très dense, Chasteau-Levallac n’est que peu marquée par le crime en raison de ses grandes patrouilles de soldats. Bien entendu, les rapines et autres roublardises ont tout de même lieu et surtout au sein des étroites rues du Petit-Levallac où ne s’aventurent qu’occasionnellement les gardes.
¶ Peuple
La population levanne est principalement composée de serfs et d’alleutiers, ne délaissant qu’une maigre densité aux notables qui gèrent la cité. Les marchands et ouvriers composent la grande majorité des habitants qui oeuvrent pour la plupart au service de nobles ou de la famille impériale.