¶ Grandes épidémies
¶ Choléra
¶ Histoire du Choléra :
Introduite par les équipages issus des terres Montelannes en l’an 486 au travers de denrées périssables souillées, le Choléra se répandit telle une traînée de poudre sur les pourtours de l’Empire de Hennequince emportant dans son sillage une très large partie de la population locale. Mêlé aux aliments et à l’eau ainsi consommés par le peuple des cités hennequines, le Choléra ne tarda pas à abattre la cité sous le poids des cadavres s’amoncellant et la virulence de ce nouveau mal gangrenant progressivement l’Empire dans son entièreté.
L’origine même de la maladie fût décelée en quelques années par les différents mires s’attelant à son étude ; le soin des sujets contaminés resta tout de même délicat à entreprendre et se solda fréquemment par la mort du fait de l’affaiblissement foudroyant dont est victime le peuple.
L’unique remède se dévoila ici dans l’élaboration de complexes systèmes d'égouts afin d’assainir les eaux. Ce n’est qu’au terme de l’édification de ces même structures que l’on fût capables d’endiguer de manière durable la maladie qui aura d’ores-et-déjà décimé plus de 30 à 40% de la population Hennequine.
L’on considère que le Choléra ne s’est que très peu développé et étendu en le Royaume montelan quoiqu’il ait pu décimer une conséquente partie du peuple hennequin. Les cités montelannes d’ores-et-déjà parées d’importants systèmes d'égouts, le Royaume endigua relativement rapidement les maux du Choléra, ceux-ci ayant davantage fait de victimes en les villages miséreux avant qu’ils ne disparaîssent d’eux-même.
L’on concentra les efforts de l’Empire Hennequin à partir du VIème siècle au rétablissement des cités tout juste établies et de l’imperméabilité de ses frontières afin de s’esquiver de nouveaux maux étrangers.
L'épidémie de choléra débuta en Hennequince en l’an 486 et dura approximativement treize années. Toutes les cités ne fûrent pas systématiquement touchées de manière hétérogène durant cette durée. Diverses vagues s’abattirent en les premières terres contaminées, permettant ainsi un répit de quelques années avant que la maladie ne reprenne. C'est-à-dire que certaines cités furent assaillies pendant 6 mois en l’an 486 avant que les cas ne se fassent plus rares puis une nouvelle flambée en l’an 491 aura ainsi lieu tandis que l’on tente d’édifier les égouts permettant potentiellement une meilleure hygiène pour les cités.
¶ Symptômes du choléra :
Moins de 25% des personnes infectées développent des symptômes et de 30 à 40% d'entre elles vont déclarer une maladie sévère. L’incubation - de quelques heures à quelques jours - est suivie de violentes diarrhées et de vomissements, sans fièvre. En l’absence de traitement, dans ses manifestations les plus sévères, le choléra est l’une des maladies infectieuses les plus rapidement mortelles : la mort survient en 1 à 3 jours, par sidération du système nerveux accompagné d'un baisse de la température centrale, d'une chute de la tension artérielle, d'un état stuporeux, parfois de convulsions dans 60 à 80% des cas.
La maladie provoque une cyanose qui colore en bleu la chair des individus contaminés. De là viendrait l'expression "peur bleue". La mortalité est plus élevée chez les enfants, les personnes âgées et chez les individus fragilisés quoique le choléra se veuille tout de même agressif pour quiconque le contractant.
¶ Traitement :
Le traitement consiste essentiellement à compenser les pertes digestives d’eau et d’électrolytes. La réhydratation est uniquement assurée par voie orale mais ne se veut bien souvent pas suffisante à la guérison du souffrant. L’on accorde parfois un traitement davantage symptomatique aux souffrants afin de leur assurer un soulagement relatif des douleurs causées par le choléra.
L’on dit qu’un infime nombre de malades parviendrait à subsister à la maladie.
L’amélioration de l’accès à l’eau potable, des mesures d’hygiène générale et de la salubrité sont essentielles dans la lutte contre le choléra.
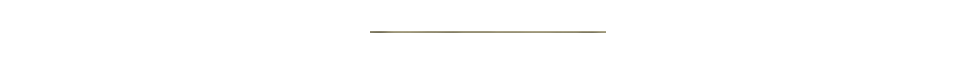
¶ Variole
¶ Histoire de la Variole :
La variole s’est vue prendre départ au coeur de la modeste cité portuaire d’Akersfjord par le biais de diverses allées et venues de marchands étrangers faisant transiter leurs ressources pas le port dorénavant montalan afin de les faire parvenir jusqu’aux îles Liljenströmn. L’on considère que l’épidémie de Variole s’est déclarée en l’an 1619 avant de se répandre hâtivement au travers des cités frontalières.
Aujourd’hui, l’on considère que sept cités différentes se voient atteintes de manière plus ou moins sévère par l'épidémie de variole. L’on compterait parmi elles : Akersfjord, Auleria, Giardinodoro, Montambrosio, Finocchiaro, Yündorthel et Mörnur.
L’on raconte que 40 à 50% de la population de la cité d’Akersfjord se verrait aujourd’hui décimée.
Récente et pour l’heure peu connue, la variole se voit demeurer telle qu’un véritable fléau pour le continent central qui ne sait jusqu’ici s’en débarrasser. Les mesures jusqu’ici adoptées par les cités les plus touchées ne se voient que peu efficaces et difficilement respectées. La mise à l’isolement des cas de variole est encore délicate à mettre en oeuvre tant l’espace et les effectifs de la garde tendant à manquer. Ainsi l’on tente parfois de regrouper les souffreteux en de vastes mouroirs improvisés dans lesquels de rares soignants tâchent d’oeuvrer. La variole se voudrait en conséquence particulièrement meurtrière de par la méconnaissance d’un réel traitement.
¶ Symptômes de la Variole :
Le délai d'incubation de la variole est en général de 12-14 jours (extrêmes 7-17 jours) ; il n'y alors pas de signe d'excrétion particulière.
L'incubation est suivie par l'apparition de symptômes de type grippal à début brutal, avec fièvre, malaise, céphalées, prostration, douleurs dorsales sévères et, moins souvent, douleurs abdominales et vomissements. Deux à trois jours plus tard, la température chute tandis que l'éruption caractéristique de la variole apparaît, d'abord sur le visage, les mains et les avant-bras, puis quelques jours plus tard sur le tronc. Les lésions se développent également sur les muqueuses du nez et de la bouche et s'ulcèrent très rapidement après leur formation, libérant de grandes quantités de liquide purulent dans la bouche et la gorge
La distribution centrifuge des lésions, prédominant à la face et aux extrémités plutôt que sur le tronc, est un signe caractéristique de la variole qui, pour un oeil exercé, évoque aisément ce nouveau fléau. Les lésions évoluent progressivement ; passant du stade de macules à celui de papules, puis de vésicules et de pustules. Dans une zone donnée, toutes les lésions évoluent simultanément. Huit à quatorze jours après l'apparition des symptômes, les pustules forment des croûtes qui laissent des cicatrices déprimées et dépigmentées si le souffrant a la rare chance de survivre à la maladie.
¶ Traitement :
Mis à part le traitement symptomatique des douleurs liées à la variole, il n'existe pas actuellement de traitement efficace afin de guérir la variole. Rares sont les souffrants jouissant de la chance de survivre à cette maladie. L’on considère ainsi que sept individus contaminés sur dix décèdent de la variole au terme d’une semaine.
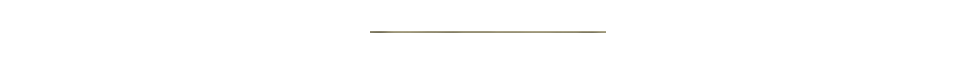
¶ Lèpre
¶ Histoire de la Lèpre :
Originellement importée par les terres gasques vers les royaumes centraux lors de l’ouverture de premières grandes voies commerciales au Xème siècle ; la lèpre se répandit progressivement au travers de la population locale.
Si les cas se voulaient tout de même relativement rares, l’on s’attela à l’élaboration de modestes édifices destinés à recevoir ces souffrants afin de les isoler de la population non touchée.
C’est cependant deux à trois siècles plus tard qu’une certaine résurgence de la lèpre fera son apparition tandis que les Royaumes de Södertälje et Monteleone se voient de nouveau officialiser de plus conséquentes relations commerciales et diplomatiques avec l’Empire Hennequin.
C’est en faisant le voeu d’endiguer cette maladie renaissante que l’on réhabilita divers édifices destinés aux lépreux tandis que l’Empire de Hennequince fît édifier un plus vaste établissement dont la gestion sera déléguée à divers adjuteurs et soignants s'engageant à porter leurs soins et compagnie aux souffrants y demeurant. L’on nomma la première grande léproserie Hennequine ; Montbajac en l’an 1578.
¶ Symptômes de la lèpre :
La lèpre existe sous deux formes principales : une forme tuberculoïde, peu contagieuse, avec des lésions cutanées dépigmentées et insensibles, associées à une atteinte inflammatoire des gros troncs nerveux et des paralysies ; une forme lépromateuse, beaucoup plus contagieuse, avec des nodules cutanés extensifs et mutilants, défigurant le visage, et disséminés à l’ensemble du corps.
¶ Traitement :
Mis à part le traitement symptomatique des douleurs liées à la formation de lépromes et lésions cutanées, il n'existe pas actuellement de traitement efficace afin de guérir de la lèpre. L’on considère ainsi que les différents individus contaminés finiront par décéder de par la gravité de la lèpre lorsque celle-ci s’est généralisée au corps entier. Son espérance de vie une fois la maladie déclarée varie de trois à cinq ans.