Suite aux événements récents, il n'est plus possible d'incarner un personnage originaire de Tislain-Ravel, sauf s'il a fui et rejoint un camp de réfugiés.
¶ Tislain-Ravel
Située à l’Est de l’Empire de Hennequince, la cité de Tislain-Ravel profite d’un climat relativement tempéré ; ainsi bordée par la Mer de Saranna. Ainsi, l’on considère la cité telle qu’un des lieux les plus propices à la modeste agriculture de l’Empire. Aujourd’hui, l’on présente la cité de l’Est telle que véritable cellier de Hennequince.
L’édification de Tislain-Ravel fût entamée en l’an 324 tandis que de solides liens commerciaux se développaient avec les terres Montelannes. L’on accorda une attention toute particulière à la fondation d’un port conséquent pouvant supporter un important afflux de navires et marchandises.
La grande cité portuaire de Tislain-Ravel fût achevée en quelques dizaines d’années avant de se voir accablée d’un important événement immobilisant dès lors le développement de celle-ci ; freinant de concert le rayonnement de l’Empire.
C’est en effet au cours de l’an 486 qu’une meurtrière épidémie de Choléra se déclara au cœur de la cité ; conséquence directe des relations commerciales ayant été nouées avec le continent central. La cité se faisant l’un des premiers lieu de commerce entre les deux royaumes frontaliers se vît ici bien largement pâtir de ces maux ; ses quartiers se voyant abattus et éventrés par les nombreux cas de Choléra s’étant déclarés. L’on considère aujourd’hui qu’approximativement 30 à 40% de la population locale fût décimée au travers de cette épidémie.
Si la cité de Tislain-Ravel se voyait destinée au développement du commerce intercontinental, l’on la réserva dorénavant uniquement à l’établissement d’un patrimoine agricole conséquent afin d’assurer la pérénité des cités locales ne bénéficiant de terres aussi fertiles.
¶
Hors des murs
Délaissés en friches durant une quinzaine d’années tandis que la population se voyait meurtrie par le Choléra ; les quelques cultures environnantes périrent afin de laisser place à de vastes étendues d’herbes folles.
Les pourtours de la cité firent quant-à eux office de fosses communes de fortune dès les premiers pics de mortalité résultant de l’épidémie faisant rage, ainsi alimentés jusqu’au ralentissement de la contamination du peuple de par l’élaboration d'égouts afin d’assainir les eaux de la cité en l’an 504. La population quant-à elle se vit rigoureusement contenue entre les murs de la cité de par l’intervention systématique de l’armée impériale afin de défendre quelconque divagation citadine jusqu’au rétablissement partiel du bourg.
Dès l’épidémie de Choléra suspendue, l’on s’attela dorénavant à vainement réhabiliter les environs de la cité afin de faire place à de nouvelles cultures nourricières. Une importante partie des dépouilles jusqu’ici massées en ces fosses furent déplacées au pied des Crêtes de Limart tandis que le reste fût disséminé vers les modestes appendices de terres à l’Est de l’Empire. Dès lors, l’on délimita de plus larges parcelles agricoles dorénavant préposées à la culture céréalière. Ainsi, l’on borda bien généreusement les pourtours de la cité jusqu’aux Crêtes de Limart de vastes étendues agricoles. L’on tâcha d’assainir tant bien que mal les terres étant les plus souillées, semant d’abord les cultures les plus éloignées avant de gagner les murs de la cité.
Si les premières récoltes ne furent pas bien fructueuses, elles finirent quoiqu’il en soit par le devenir au fur-et-à-mesure que les années filaient et que les terres étaient battues.
L’on considère que la cité fût libérée de ces maux en seize années ; ses cultures prospérant désormais plus largement que tout autre bourg impérial.
Ainsi de conséquentes étendues de cultures céréalières et légumières viennent aujourd’hui morceler les environs de la cité dans lesquelles s’animent une grande majorité de paysans. De nombreuses fermes viennent quant-à elle s’installer sur les côtes de champs afin d’y faire paître leur bestiaux lorsque ceux-ci ne sont semés.
Seules les grandes voies liant les bourg locaux à Tislain-Ravel viennent fendre ces reliefs agricoles en de larges chemins déblayés permettant les allées-et-venues d’imposantes cargaisons et charrettes.
¶ Quais Inertes
Si l’on accorda une attention particulière à l’élaboration d’un imposant port lors de l'édification de la cité, celui-ci se vu longtemps clôturé une fois l’épidémie généralisée. Les différents quais pâtirent en conséquence de l’inactivité soudaine du port, leurs structures faiblissant progressivement.
Aussi, c'est au terme de la propagation de l'épidémie que l’on entama la rénovation totale du port en l’an 504 ; de concert avec l’expansion des premiers égouts fraîchement bâtis.
Ainsi l’on ne tarda pas à offrir à la cité de plus importantes infrastructures permettant ici l’amarrage de nombreux navires marchands provenant des terres les plus éloignées de l’Empire.
Désormais, le port se voit bien largement sollicité et impliqué dans l’exportation de denrées diverses relevant de la forte production agricole de la cité vers les pans de l’empire souffrant de l’infertilité des sols.
Initialement majoritairement composé de bois, les différents quais articulant le port se voient dorénavant renforcés d’imposantes masses de pierres disposées aux pieds de ceux-ci. L’on pava les principales allées menant au port jusqu’aux quais de pierraille auprès desquels viennent s’élever de grands entrepôts faisant liaison avec le modeste chantier naval.
¶ Allée de Soufre
L’Allée de Soufre se présente telle que les bas quartiers de la cité de Tislain-Ravel, accueillant là les vestiges d’un douloureux passé marqué par la maladie et la misère. L’architecture du quartier se veut ainsi tout au plus ancienne et par conséquent fragilisée par l’usure du temps. Les premières demeures y ayant été bâties furent essentiellement composées de bois et matériaux de récupération que l’on consolida vainement par de modestes fondations de pierre.
Le quartier doit sa dénomination particulière aux effluves nauséabondes ayant écrasé le quartier durant les fortes années de l’épidémie de Choléra ayant sévi en la cité. L’on raconte que les relents cadavériques émanant des fosses voisines imprégnaient les murs de la cité ; semblables aux amères senteurs de soufre.
Les bas quartiers de Tislain-Ravel regroupent dorénavant une majorité de la petite populace œuvrant en les ateliers voisins en qualité d’ouvriers. Si l’Allée de Soufre se veut en grande partie accueillir les baraquements des ouvriers miséreux de la cité, quelques entrepôts viennent tout de même prendre place aux extrémités des quartiers.
L’on retrouverait également divers accès aux égouts au niveau de modestes postes de garde encadrant le quartier jusqu’aux remparts de la cité.
¶ Place de Bastringue
La place de Bastringue se voit demeurer le cœur de la cité, accueillant ici les divers marchés rythmant la semaine de la population locale où se marchande une partie des fruits de la récolte saisonnière.
De nombreux ateliers d'ébénistes et quelques modestes forges viennent ici articuler les principales allées traversant le quartier de Bastringue tandis que de plus larges appartements prennent place à l’étage de ceux-ci ; composant là de hautes bâtisses abritant commerces et commerçants sous un même toit. Tavernes, auberges et lieux de divertissement viennent à leur tour border les diverses échoppes marchandes jusqu’à lier les ruelles exiguës du port inerte menant aux rares lupanars tentant de prospérer au travers de la cité.
Une semaine par mois se déroule un plus vaste marché durant lequel de nombreux villageois et marchands de cités voisines viennent s’acquitter de conséquentes quantités de denrées, offrant à leur tour quelques ressources minières manquant cruellement à l’Est de l’Empire.
Les séquelles d’une épidémie meurtrière persistent tout de même au travers d’un flanc du quartier ayant été incendié lorsque la garde immola un mouroir à souffreteux où s’amassaient individus contaminés et cadavres.
Si les quelques bicoques ayant été emportées dans l’incendie du dispensaire furent reconstruites dès la réhabilitation de la cité, le mouroir quant-à lui ne fût jamais remis en état. L’on le délaissa finalement, quelques ruines calcinées subsistant à peine.
Les quelques rares lieux accueillant le labeur de mires furent cependant rapidement réhabilités et massés en une large allée groupant ici alchimistes divers, apothicaires et soignants. De hautes vitrines chargées de décoctions et préparations de toutes sortes viennent parer ces ruelles imprégnées de douces effluves florales résultant probablement des parfumeries y ayant pris place.
¶ Quartier Consacré
Essentiellement composé de pierre et colombages divers, l’on érigea le Quartier Consacré telle que l’œuvre phare de la cité. Son architecture elle même vient à son tour dénoter de l’ensemble de quartiers, la pierre y étant bien largement préférée tandis que les plus hautes bâtisses arborent de surprenantes toitures colorées ; à l’image des hauts-quartiers de riches cités de l’Empire.
Y prennent alors place les luxueux commerces tels qu’ateliers de haute-couture, parfumeries faisant lien avec l’Allée des mires au cœur du Quartier de Bastringue ainsi que de rares tavernes. La caserne quant-à elle marque la jointure entre le quartier de Bastringue et les hauts-quartiers ; la cour de celle-ci s’étendant plus vastement vers la place.
De fréquentes rondes sont ici exécutées au travers du quartier et plus généralement de la cité. De plus nombreux détachements viennent cependant garder les hauts quartiers où se sont établis les différentes personnalités de la cité.
L’on retrouve en leur coeur divers palais ; propriétés secondaires ou principales de maisonnées notables. Une majorité des bâtisses s’élevant en le quartier demeurent cependant de plus modestes appartements offrant à la bourgeoisie souhaitant s’établir une proximité toute particulière à la haute-société.
De maigres parterres fleuris et places de verdures bordent à leur tour le précieux quartier accueillant là marbres, statues et fontaines diverses.
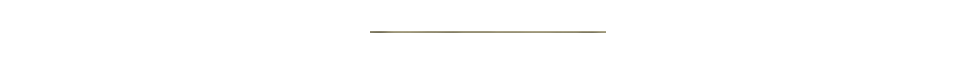
¶ Économie
¶ Commerce
Profitant aujourd’hui de terres toutes au plus fertiles et d’abondantes cultures céréalières et légumières, la cité de Tislain-Ravel s’est affirmée ici telle que grenier principal de l’Empire de Hennequince. L’on dit que son commerce de grain de Tislain-Ravel serait le plus florissant de l’Empire.
Sa proximité avec les vastes bois bordant les Crêtes de Limart permet à son tour une confortable exploitation forestière afin de subvenir aux quelques besoins des artisans locaux oeuvrant en les menuiseries, ébénisteries et au coeur du chantier naval.
¶ Artisanat
L’artisanat de la cité de Tislain-Ravel se concentre ici majoritairement dans le travail du bois. S’il demeure aujourd’hui essentiellement composé d’ébénistes et de menuisiers, l’on dit que l’Empire tend à dépêcher davantage d’artisans capables d’étendre la flotte impériale.
Le port se verrait ainsi d’autant plus animé par la venue de moult marins, armateurs et architectes navaux.
¶ Richesse locale
Comptant plus de greniers que n’importe quelle région de l’Empire, Tislain-Ravel se caractérise telle qu’une cité riche et très prospère grâce à ses richesses en grain et en bois. En effet, l’exportation commune de blé, orge, avoine, maïs, arbouses et pyrole commune ajoutent régulièrement à la fortune de la cité.
¶ Société
¶ Criminalité
La criminalité de Tislain-Ravel ne se voit pas plus accrue que quelconque autre cité. Le vol, le meurtre ou les règlements de comptes sont d’occasionnels malheureux incidents rythmant les journées de la population locale.