¶ Histoire
Située près d’un carrefour routier très fréquenté, la ville de Valenrgue a d’abord été un simple rassemblement d’étals de marchands, qui y ont ensuite installé leurs habitations. L’augmentation des échanges - et donc des voyageurs - a poussé un chef local, Ghislain, à y édifier un poste d’octroi pour asseoir son autorité sur le territoire. La première mention de Valenrgue apparaît sur un registre de comptes de l’octroi daté de 401, mais l’étymologie du nom n’a jamais été clairement définie.
Profitant de sa situation géographique, le hameau de Valenrgue devient vite un bourg attractif pour toutes sortes de populations, du marchand aisé au crève-la-faim à la recherche de travail. Mais très vite les faibles effectifs des hommes du seigneur de Valenrgue s’effacent devant les différentes bandes armées qui sèment la terreur et qui s’affrontent pour le contrôle de l’agglomération. Dès l’an 402, le bourg marchand est la plaque tournante de tous les trafics, et de nombreuses bandes de malfrats profitent de ce carrefour commercial pour écouler plus ou moins légalement le butin de leurs escapades sur les routes environnantes. Le commerce avec le royaume d’Hennequince est fortement impacté par ces coupe-jarrets qui attaquent les caravanes du sud du pays, et l’installation de petites garnisons n’améliore que peu la situation, les brigands profitant de la présence de zones boisées pour disparaître... ainsi que de l’absence d’accords entre les deux entités politiques pour passer la frontière devant les troupes d'Hennequince. La voie diplomatique n’amène aucun changement non plus, car la dynastie des Ghislain est neutralisée par un aréopage de conseillers plus ou moins intéressés n’ayant aucun intérêt à faire pourchasser les bandes. De plus, le dernier héritier en date, Lorin, n’est pas apte à exercer le pouvoir suite à une intelligence bien en dessous de la moyenne… délaissant les affaires à son connétable Henri Fleurin. Ce dernier n’a cependant pas l'acuité politique nécessaire pour gouverner efficacement ; de l’autre côté de la frontière, les milieux d’affaires, lassés de payer de plus en plus cher les mercenaires pour escorter leurs caravanes, font pression sur le parti belliciste pour régler ce problème. Flairant l’opportunité de rajouter une terre à son domaine, le roi de Hennequince Albéric II invoque la nécessaire sauvegarde des intérêts de son peuple pour franchir la frontière avec son ost au début du printemps 405. Face à une armée disciplinée et organisée, les bandes armées du seigneur de Valenrgue sont balayées en quelques jours, et le bourg occupé. Lorin et sa soeur, capturés par le régiment du Promontoire, sont discrètement éliminés afin de prévenir toute velléité de rébellion, laissant le roi d'Hennequince ajouter une nouvelle pierre à sa couronne.
En l’espace de quelques mois, le calme est revenu à Valenrgue. La première action d’Albéric II est de neutraliser les bandes en jouant sur les rivalités tout en installant un Guet conséquent. Reconnaissables à la croix blanche peinte sur leur plastron, les sergents de ville imposent un couvre-feu strict, n’hésitant pas à battre les récalcitrants à coups de bâton. Enfin, une fois la cité épurée de ses éléments perturbateurs et un gouverneur loyal à Albéric II installé, la région reçoit de nombreux avantages fiscaux pour son développement économique. L’octroi est baissé de moitié, tandis que de grands propriétaires terriens achètent des domaines à bas prix qu’ils défrichent pour profiter de la fertilité des terres. En quelques saisons, des champs de céréales s’étendent à perte de vue tandis que les principaux cours d’eau sont déviés pour assurer l’irrigation ; en 10 ans, Valenrgue voit sa population tripler et son centre marchand accueille de nouvelles halles dans lesquelles est organisée une gigantesque foire agricole une fois par mois. Au fil des ans, l’événement parvient à se faire un nom dans tout le royaume d’Hennequince, attirant de nombreux commerçants mais aussi toute une foule d’usuriers qui se réunissent dans un même quartier, celui d’Aiguebelle, avantageusement situé à côté des halles.
Lors de la décennie 420-430, la situation agricole de la région s’améliore d’une façon exponentielle. Des lettres de voyageurs traversant la région de Valenrgue en témoignent : des arpents de vignes somnolent à perte de vue, et des champs de céréales immenses blondissent sous le soleil du printemps. Cette situation coïncide cependant avec l’arrivée de plusieurs dotés, qui ne sont pas encore appelés tels quels et qui semblent cacher leur propension à donner un « coup de pouce » - en fait, ces derniers sont grassement payés par des propriétaires terriens au fait de leurs talents en échange de leur silence, purement intéressé par la conservation de leur propre avantage. Le développement des échanges bénéficie grandement à la cité qui continue de prospérer jusqu’en 486, quand les premiers cas de choléras importés par des marchands se déclarent à Valenrgue. La maladie va frapper en plusieurs vagues, décimant près d’un tiers de la population Valenrguoise sans distinction ; la fin de chaque nouvelle vague est guettée anxieusement par tous, redoutant encore plus la prochaine. Mais à partir de l’an 512 la décrue semble pérenne, sans que les médicastres notent l’apparition d’un nouveau cas annonciateur d’une rechute. Commence alors une longue période de convalescence pour Valenrgue - et Hennequince en général - pendant laquelle les échanges commerciaux sont au point mort. Dévastées par le choléra, les infrastructures de transport tournent au ralenti, ralentissant considérablement la reprise économique. De longs convois de miséreux et de vagabonds se forment alors sur les routes, convergeant vers les cités, où ils espèrent recevoir des soins et de quoi nourrir leur famille grâce aux aides du Panthéon; Valenrgue n’en est pas exclue et devient en quelques mois l’agglomération comptant le plus de religieux à la ronde. L’aide alimentaire est bien sûr accompagnée d’une aide spirituelle, le Panthéon voyant en ces temps troublés une raison de l’inconstance des Hommes.
Ce n’est qu’à partir de 550 que la région de Valenrgue commence à remonter la pente. Grâce à plusieurs bonnes années de suite, l’agriculture reprend du poil de la bête, même si les conséquences de l’épidémie sont toujours dans tous les esprits. La dynamique d’expansion de la cité lancée avant le choléra est cependant brisée ; les terres libres se font rares, et une superstition vivace empêche la reprise d’un commerce à outrance. Malgré cela, l’affluence de membres du Panthéon a fait passer Valenrgue d’un énorme centre d’échanges à un haut-lieu de la spiritualité, les trois courants s’y développant petit-à-petit, étirant leur emprise sur chaque quartier.
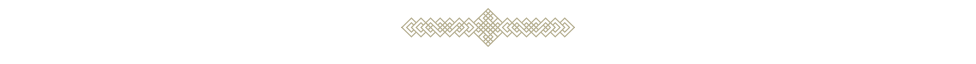
¶ Quartier d’Aiguebelle :
Fermement tenu par les modérantistes, le quartier fait figure de centre d’affaires avec beaucoup d’établissements financiers ou de facilitateurs, courtiers, assurances etc. Sa position médiane au niveau des courants religieux lui permet d’attirer les populations diverses, avec une majorité de grands commerçants. Au sein même du quartier et du courant, plusieurs tendances (soit laudateur, soit puritain) se détachent, sans parvenir à prendre le dessus, la cohabitation étant plus ou moins acceptée. Plusieurs petites bandes vivotent du rançonnage et des différents larcins, se livrant parfois à de véritables batailles rangées pour le contrôle d’une rue ou d’une venelle. De nombreux postes de surveillance du Guet s’y trouvent afin de pouvoir intervenir le plus vite possible.
¶ Quartier de la Javie :
Population plus artistique, car la dotation y est plutôt tolérée et donc très côté “ouverture d’esprit”. Bourgeois, petite noblesse, et quelques familles de très nobles qui portent le courant laudateur à bout de bras. Beaucoup d’établissements de loisirs très fréquentés et plus ou moins hauts de gamme (lupanars, tavernes, auberges). Quartier traditionnellement « nocturne », la petite pègre en a été écartée par deux familles, les Montaron et Calot, qui ont la mainmise sur les lieux de divertissement après l’épidémie de choléra. Depuis, les deux familles ont disparu, mais les tire-laines n’y sont jamais revenus. À noter qu’en 1461, une petite bande (dite « de Bringuois ») a tenté de prendre la main sur le quartier sans y parvenir, ses manœuvres étant déjouées par le Guet lors d’une période précédant les élections.
¶ Quartier de Bramejean :
Plus tourné vers les traditions, ce quartier est aussi celui des grands artisans et de ceux qui se destinent à une vie loin de la dotation. Une foule de citoyens évoluant entre deux eaux, une véritable classe moyenne de petits bourgeois. Sous la coupe des adjuteurs puritains qui disposent d’un solide réseau d’informateurs, le quartier de Bramejean n’est pas « accueillant » pour la criminalité, malgré quelques affaires rocambolesques menées par des monte-en-l’air.
¶ Quartier du Faubourg :
Quartier en marge, pas vraiment institutionnalisé mais qui regroupe beaucoup de pauvres, et donc fort taux d’arrivées/de départs. Peu préoccupés par les considérations religieuses, les habitants sont le terrain de chasse des adjuteurs des trois autres quartiers. Cependant, comme il n’y a aucune hiérarchie et que les gens ne restent jamais trop longtemps, aucune tendance majeure ne se détache. La population de Valenrgue ne s’y rend presque jamais, plus par peur de la « pauvreté » que de la réelle criminalité qui est beaucoup plus axée sur la traite d’êtres humains que de la rapine.
¶ Lieux clés
Chaque quartier dispose de plusieurs lieux clés, étant soit la raison pour laquelle la faction s’est établie ici, soit le résultat de l’implantation de la faction.
- Quartier modérantiste : La Maison est un ancien atrium qui a été voué par un patricien au culte du panthéon, avec des statues de chaque déité sur le pourtour. Attirant de nombreux fidèles, le lieu a fini par devenir un centre de rencontre important entre adjuteurs et fidèles souhaitant exprimer leur foi. La famille de Lucio conserve un droit de regard sur ce qu’il s’y fait, notamment au niveau des aménagements, mais l’éloignement progressif des générations ont érodé leur système de contrôle
- Quartier laudateur : Fontaine de la Javie. La légende dit que lors d’un été de grande sécheresse, la fontaine principale du quartier ne laissait plus couler qu’un petit filet d’eau fraîche. Est alors arrivé un doté qui s’est approché de la fontaine et en a fait rejaillir l’eau, avant de vaciller puis de quitter la zone. C’est suite à cela que des modérantistes sont devenus des laudateurs, voyant que la dotation pouvait aussi sauver des vies. La fontaine demeure un lieu de pèlerinage de nos jours, nimbée d’une aura presque sacrée, la coutume étant de recueillir de l’eau dans ses mains, d’exprimer ses souhaits ou ses voeux avant de les rouvrir.
- Quartier puritain : Le mur des martyrs. Le mur en lui-même est un ancien mur d’enceinte d’un entrepôt de grains. En 1452, alors que la bande de Main-d’Argent (une dizaine de dotés de plus ou moins grande envergure, mais dont le chef, Eirin, semble être puissant) tente de placer le quartier sous sa coupe, des adjuteurs se rendant dans le quartier d’Aiguebelle sont capturés par les tire-laines. Eirin cherche à en tirer une rançon, mais la capture de ces religieux fait figure de basculement auprès de la population qui jusque là se contentait d’être passive. Sentant le vent tourner, certains membres commencent à faire comprendre à leur chef qu’ils sont peut-être allés trop loin ; inflexible, Eirin insiste pour attendre la réponse à la rançon. Mais un soir, un des larrons libère les adjuteurs, qui s’enfuient… pour tomber face à Eirin en chemin. Alors que le vacarme commence à rameuter le voisinage, le chef de la bande panique et tue les captifs grâce à son pouvoir. Cette action, l’affaiblissant considérablement, motive un membre du Guet à venir le poignarder, la population se joignant à la curée. Le mur contre lequel les adjuteurs ont été tués est depuis devenu un lieu très respecté, preuve matérielle selon le courant puritain que la dotation n’apporte que misère et désolation, et les adjuteurs les plus puritains ont décidé quelques jours après de maintenir en état le lieu, le service au sein du groupe des « surveillants » étant considéré comme une marque de prestige parmi les individus d’obédience puritaine. Il est interdit aux fidèles de toucher le mur ; dans le cas contraires, les « surveillants » portant une aube rouge sang peuvent s’interposer.
- Sanctuaire de Valenrgue : Reconnu tel que l’un des plus prestigieux édifices religieux, le Sanctuaire de Valenrgue fascine le continent entier, de nombreux pèlerinages étant exécutés tout au long de l’année pour se rendre en le cœur même du Panthéon hennequin.