Suite aux événements récents, il n'est plus possible d'incarner un personnage originaire de Montroissan, sauf s'il a fui et rejoint un camp de réfugiés.
Fort de Montroissan
Le fort de Montroissan fût édifié aux alentours de l’an 379 au coeur même de ce qui fût jadis le Royaume de Limart avant de se voir entièrement englobé en l’Empire Hennequin.
Véritable place forte et principal réservoir de la cavalerie hennequine, le fort de Montroissan se constitue aujourd’hui tel qu’imprenable place forte alimentant l’armée impériale.
Affaiblies par les violentes flambées de Choléra de l’an 486 alors issues du Royaume de Monteleonne avec qui le continent hennequin s’attelait à moult échanges commerciaux ; les troupes du fort de Montroissan se virent relativement touchées par ces maux meurtriers. Ainsi celui-ci connut un fort ralentissement quant-au développement de son économie locale avant que les égouts ainsi entamés au terme de l’édification des premiers quartiers ne soient achevés. Une fois de vastes réseaux d'égouts dressés dans le but d’assainir les eaux environnantes, les différents mires peuplant le fort en quête de prospérité se penchèrent davantage encore à même l’épidémie de Choléra se répandant au travers du continent afin d’en défaire le peuple qui se voyait d’ores-et-déjà sévèrement meurtri.
La première vague de Choléra s’apaisa en quelques mois seulement tandis qu’elle tendait à irradier vers les cités de l’Ouest. Une seconde flambée tout autant meurtrière se déclara cependant quatre années plus tard avant d’abattre quelques centaines d’habitants locaux. L’on considère que le Choléra fût officiellement défait du continent treize années après la première flambée, en l’an 499.
Le 9 février 1625, Montroissan sombra. Ainsi qu'une créature monstrueuse jaillie des entrailles de la terre, une horde de décharnés sous l'égide du Porte-Silence s’abattit sur la cité, charriant avec elle une pestilence de mort et de malheur. Ce fut une nuit d’horreur où le ciel, noir de suie, s’ouvrit sur les flammes des bûchers improvisés, où l’on crut entendre les murailles, ces fières murailles autrefois réputées imprenables, gémir sous l’assaut implacable des damnés.
Les rues, hier encore pleines de rumeurs marchandes et de rires d’enfants, se remplirent de cris de terreur. Dans une panique folle, les habitants couraient, trébuchaient sur les pavés souillés de sang, se heurtaient aux portes closes. Ceux qui ne furent pas fauchés par les griffes des spectres tentèrent de fuir, abandonnant derrière eux maisons, souvenirs et promesses d’avenir. Les plus malchanceux, réfugiés dans les caves ou tapis dans l’ombre des ruelles, ne trouvèrent qu’un répit amer, condamnés à attendre une fin inéluctable.
Montroissan n’est plus. Ce qui fut une cité vivante et orgueilleuse n’est plus qu’un tombeau aux mains d’êtres impies. Chaque pierre, chaque ruine suinte le désespoir. Les rares âmes égarées qui osent encore s’en approcher murmurent que les revenants rôdent toujours, inlassables sentinelles d’un empire de cendres et de mort.
¶ Quartier Vermillon
Le quartier Vermillon se veut concentrer l’essentiel de la population en son sein, celui-ci accueillant ainsi les différents paysans oeuvrant au dehors des murs du fort afin d’y entretenir champs et élevages porcins. Principalement caractérisé par sa particularité architecturale, le quartier Vermillon doit son appellation à la teinte des briques beigeâtres composant les imposants édifices y demeurant ; ceux-ci s’étant au fur-et-à-mesure colorés de rouge tandis que la bruit rongeait progressivement leur teinte initiale. Aujourd’hui, le quartier Vermillon se verrait entièrement parés de larges trainés écarlates lézardant ses murs de par la composition élevée en sable rougeâtre des briques ayant été utilisées à la fabrication des premières bâtisses.
Quoique le quartier se fasse conséquemment peuplé, les ruelles s’articulant en son coeur se voient relativement larges et minutieusement pavées afin d’y favoriser le passage de calèches, charrettes et pelotons de cavaliers armés. Chaque quartier profiterait d’une caserne lui étant propre destinée à la garde de son arrondissement. L’on compterait approximativement plus de deux-cents hommes en chaque caserne, ceux-ci s’activant habilement au travers des chemins de ronde, murailles et ruelles du quartier. Les effectifs seraient vraisemblablement doublés la nuit durant afin de s’esquiver des divers larcins que la pénombre favorise.
Les demeures se voulant les plus anciennes se voient maintenant peu peuplées, voire abandonnées par crainte que les fondations de celles-ci ne s’y écroule. Seuls les foyers les plus modestes se verraient ainsi confinés en ces baraques insalubres et vieillies ; leurs murs ne se faisant ni étanches ni correctement isolés de la fraîcheur des terres. L’on raconte que certains de ces fragiles édifices feraient d’excellents lieu de rencontre pour la pègre locale, certaines se voyant liées à d’anciens réseaux d'égouts aujourd’hui peu utilisés ou condamnés.
¶ Allée d’Honneur
L’allée d’Honneur fût autrefois le quartier accueillant la plus grande majorité des habitants du fort avant que l’épidémie de Choléra n’en décime bon nombre des foyers. Moult demeures ayant abrité malades et dépouilles furent incendiées par crainte que le choléra ne se déclare de nouveau. Ainsi tandis que l’épidémie s’apaisait progressivement, la population migra au fur-et-à-mesure vers le quartier Vermillon que l’on s’échina à restaurer. L’on lia les différents quartiers par de grands réseaux d’égouts souterrains afin d’endiguer les maux faisant faiblir le fort.
Différents dispensaires et mouroirs improvisés en l’an 486 furent condamnés durant trois à quatre années avant que l’on ne les réinvestisse enfin. La plus grande partie de la population ayant dorénavant quitté l’Allée d’Honneur, l’on y édifia une grande place se constituant ainsi telle que le centre du fort au coeur duquel moult étals et échoppes viendraient prendre place au travers de marchés hebdomadaires. L’on édifia de nombreuses boutiques surplombées de quelques habitations afin d’y accueillir artisans et marchands. L’on compte une vingtaine d’entrepôts en l’Allée d’honneur, ceux-ci ayant pour nombreux d’entre eux écrasé les anciens édifices employés tels que dispensaires de fortune lors de la seconde flambée de Choléra.
Au terme de la seconde vague meurtrière de l’épidémie, l’on fît dresser une vaste autel religieux aux côtés d’un haut monument aux morts en hommage aux nombreuses victimes du choléra et soignants ayant investi leur vie à la protection des souffreteux.
¶ Quartier de l’Aube
Le quartier de l’Aube regroupe ici les hautes-instances du fort de Montroissan ainsi que la troisième et dernière caserne se voulant être la plus vaste. Celle-ci se verrait bordée d’un immense terrain d’entraînement au coeur duquel seraient formées moult recrues. Liée à de plus larges chemins de ronde, la caserne se veut conserver un accès particulier aux murailles du fort lui étant greffées. Celles-ci mèneraient alors directement vers la caserne respective de chaque quartier, permettant ainsi une surveillance des murs tout au plus rigoureuse. L’on aurait dorénavant accordé un fastueux haras ayant été élaboré hors des murs à l’investissement des écuries de la caserne principale en montures. Le manège y étant accoté se verrait ainsi fréquemment utilisé afin d’enseigner l’équitation et le combat à dos de cheval aux diverses recrues.
La caserne elle-même se veut faire face à la grande citadelle accueillant noblesse et courtisans. Celle-ci quant-à elle se verrait surplomber la cité de par ses hautes tours de pierre et de plâtre sublimées d’une timide végétation prospérant tout de même en ce climat relativement frais.
D’importantes forges et armureries diverses viendraient à leur tour prendre place au coeur de la place liant Allée de l’Honneur et Quartier de l’Aube au travers de moult ateliers destinés au ravitaillement en ressources des différentes casernes. L’activité principale du quartier se verrait concentrée en la forge.
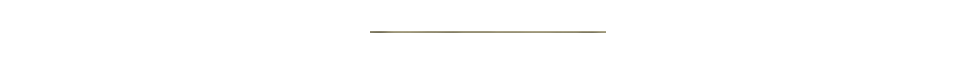
¶ Économie
¶ Commerce
Auto-suffisant grâce à ses cultures et ses élevages, l’immense forteresse reçoit en cas de pénuries ou de mauvais rendements des ressources des greniers de Tislain-Ravel.
Une majorité des artisans présents se résument approximativement aux forgerons fournissant au besoin la caserne interne à la forteresse. L’activité du fort demeure majoritairement agricole et militaire quoique l’on puisse tout de même compter sur quelques exportations minières vers les cités frontalières.
¶ Richesse locale
Jouissant d’une particulière proximité avec les terres côtières profitant d’un climat plus doux, le fort de Montroissan se voit apte à la cultivation de diverses denrées nourricières telles que choux, courges, blé, avoines et divers céréales. Celui-ci viendrait ainsi soutenir les exportations de denrées des greniers frontaliers lorsque les cités les plus reculées se verraient victimes de pénuries et famines.
¶ Société
¶ Criminalité
Véritable forteresse composée du plus grand nombre d’hommes armés, le fort de Montroissan se voit profiter d’une sécurité tout au plus pointue. Chaque caserne installée dans les différents quartiers dispose bien souvent d’une mission particulière à laquelle elle doit accorder la majorité de ses efforts. Ainsi certaines se voient assignées à la garde intra-muros tandis que d’autres se trouvent disposées à même les murailles afin d’y garder la cité.
La pègre cependant demeure bel-et-bien au cœur du fort quoiqu’elle se fasse relativement discrète. La répression se voyant forte, il est davantage commun que les groupes criminels sévissent de nuit au cœur des systèmes d'égouts les plus vétustes.