¶ L'Emanation de la Foi
Il n'y a pas de texte fondateur révélant une parole divine chez les complétionistes mais un ensemble de plusieurs contes mythifiés. Les trois contes principaux retracent l'existence des prophètes ayant développé la pensée religieuse. Ils constituent l'épicentre de la spiritualité des croyants et véhiculent une certaine interprétation de l'homme et de son rapport au monde.
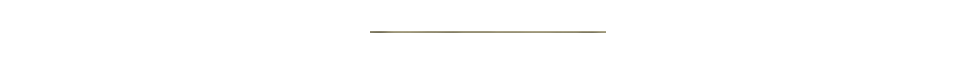
¶ Prospertia : découverte de la spiritualité de l’humain
Prospertia est considérée comme étant la première prophétesse à avoir découvert l’existence de la spiritualité de l’humain. La légende raconte qu’elle changea de nom sur invitation de la divinité pour propager la parole sainte et signifier sa proximité avec l’homme. Il est communément admis que son premier nom fut Ottavia.
D’aucuns prétendent qu'Ottavia, future Prospertia, vivait dans une communauté rurale de chasseurs-cueilleurs, non loin de ce qui serait bien des années plus tard, le haut lieu de la Foi : Farhas. Benjamine d’une très nombreuse fratrie, Ottavia se distingua rapidement de ses frères et soeurs par sa précocité et sa maîtrise du langage alors qu’elle était toute jeune. Elle fut dès sa prime adolescence une cueilleuse et herboriste assidue au sein d’une communauté en plein essor. La pratique de l’élevage et de l’agriculture naissaient à peine et donnaient enfin à l’homme une raison de s’installer durablement.
La légende raconte qu’une fois installés, la prospérité de la communauté s’en trouva décuplée. Plusieurs années s’étant écoulées, Ottavia était mère de famille et commençait à sentir le poids des années sur ses frêles épaules. Charismatique, elle occupait une place de choix parmi les siens et ses congénères révéraient ses précieux conseils. Herboriste accomplie, mère comblée, autorité de la communauté, Ottavia restait ce qu’elle fut toujours : une femme morose, bien qu’elle surmonta avec succès les étapes de la vie de l’homme : s’émanciper, assurer sa subsistance, fonder une famille, garantir sa sécurité. Une vie réussie et bien remplie se permettaient de commenter ses contemporains. Malgré les brèves joies qu’elles lui apportèrent, ses réussites ne la comblaient pas. Elle se convainquit alors qu’elle eût atteint un palier et non un sommet.
Ottavia questionna la routine qui s’installait dans son quotidien et commença une existence d’ermite alors qu’elle s’éprit de ses promenades champêtres. Elle assimila très tôt la différence entre l’homme et la bête. Elle comprit que la bête ne pouvait s’émanciper du cycle naturel qui la contraignait : elle assure sa subsistance, se reproduit et répète ce cycle. L’humain lui, assure sa subsistance, se reproduit et évolue. Il est doué d’une sensibilité étrangère à la plupart des bêtes.
Forte de ses réflexions, elle propagea son savoir nouvellement acquis pour orienter l’existence de ses contemporains et faire émerger chez eux la conscience de leur sensibilité.
Les croyants connaissent le mythe d’Ottavia-Prospertia sous la forme d’une ballade, parfois chantée, où la prophétesse rencontre au fur et à mesure de ses pérégrinations méditatives une émanation divine. Dans la ballade, le caractère divin de Prospertia est représenté par un coquelicot, symbole du Completionem. Prospertia est une divinité duale s’incarnant dans l’homme et la nature : elle fait l’objet de nombreux débats parmi les intellectuels et les théologiens. Les croyants ont bien assimilé qu’elle était en chacun d’eux, et que tous pouvaient prétendre à avoir un lien privilégié avec elle. Néanmoins, seules les personnalités les plus éduquées saisissent l’enjeu philosophique et théologique derrière le mythe.
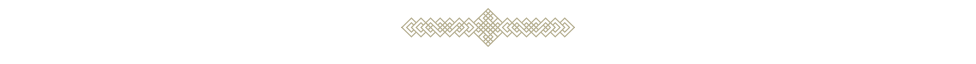
¶ Rikhard : découverte du besoin de vivre en société
Rikhard est le second grand prophète de l’histoire de la Foi, à qui l’on doit la réflexion sur le besoin de vivre en société. Donnant suite à la pensée d’Ottavia, le prophète vient la renforcer et la développer à travers de nouvelles réflexions. L’Homme doit-il se contenter de travailler sur sa part de divin ou a t-il besoin de la présence de son prochain pour la développer efficacement ? De cette réflexion naissent les premières véritables sociétés, organisées autour de la recherche du développement de l’Homme et de sa spiritualité. Chacun est placé sur un même pied d’égalité et doit travailler pour son voisin avant de travailler pour lui-même. La foi commence à occuper une place de plus en plus importante et réunit de plus en plus d’adeptes. Certains voient cependant d’un mauvais oeil la formation de tels groupes, véritables nuisances pour le développement et les ambitions personnelles, considérant que certains sont prédisposés à développer leur part de divin plus efficacement par l’épanouissement personnel, à travers la quête de richesse et de pouvoir.
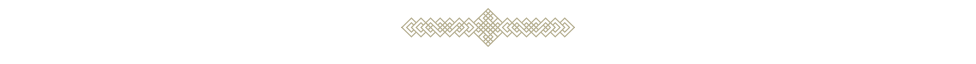
¶ Imanéa : découverte de la dictature des passions et de la recherche de l’ataraxie
Imanéa est le troisième prophète d’importance au sein de la liturgie complétioniste. Son histoire a été très largement mythifiée pour faire place à une légende dont la morale vient asseoir le dernier pilier de la Foi complétioniste. Il est dit d’elle qu’elle fut une femme de bonne naissance, tantôt bourgeoise, tantôt noble, elle aurait mené une vie d’ascète. Relativement réservée, douée d’un esprit vif, elle se révèle être une fine observatrice tirant profit de son attitude de spectatrice des événements qui l’entourent. Consternée par les jeux de cour, elle se prend d’affection pour le petit peuple et fit l’expérience d’une vie hors des manoirs et châteaux.
A l’origine stimulant, son séjour parmi les indigents finit par lui laisser une certaine amertume : elle s’attriste de retrouver les excès de l’envie, de la jalousie, de l’ambition et de l’amour. Déçue mais non moins résolue, elle assimile studieusement les enseignements philosophiques et théologiques des prophètes fondateurs de la Foi. Imanéa s’interroge sur la spiritualité et la nature sociale de l’homme : ni la spiritualité, ni la vie en communauté n’ont pu résoudre les vices sommeillant en chaque être humain. La spiritualité n’a pas guéri les humeurs de l’humain, tout comme les communautés des hommes n’ont pas posé les jalons d’une existence pacifiée.
Elle se décida alors à revenir aux racines de l’existence en quittant les lieux de “modernité” pour fonder une nouvelle société afin d’en observer les progressives évolutions. Imanéa fit l’hypothèse que les sociétés font face à un manque : si la spiritualité et les communautés ont failli, il devait demeurer un échec dans la conception de la vie bonne recherchée par l’homme. Selon les écoles de théologie elle fonde cette société “nouvelle” aux côtés d’une communauté de fidèles l’ayant accompagnée ou en intégrant une communauté primitive préexistante qu’elle parviendra finalement à organiser.
Imanéa se rendit compte que malgré l’émergence d’une spiritualité donnant conscience à l’homme et une société garante d’une tranquillité, les relations humaines n’ont pas été transformées mais seulement modifiées. Si la compétition pour les ressources engendre la violence chez les sociétés primitives, la compétition pour l’exercice du pouvoir engendre la violence chez les sociétés civilisées. Ce n’est pas seulement l’environnement de l’homme qu’il faut changer, mais c’est l’homme lui même conclut-elle. L’humain est faillible car est un être doué de sensibilité : il ressent et est émotif. N’importe quel environnement est susceptible de générer ces émotions néfastes : qu’il soit civilisé ou primitif.
Imanéa revint alors parmi les civilisés et prêcha une doctrine de l’ataraxie invitant les hommes à maîtriser leurs émotions et se dissocier de leur corps sensible pour atteindre leur esprit, doué de raison.