¶ Introduction
Le clergé séculier - c’est à dire le clergé vivant parmi et avec les communautés des croyants - est la branche du Completionem ayant le plus grand nombre de membres. Il s’organise en paroisses, à la tête de chacune se trouve un archiprêtre auquel sont inféodés des prêtres. Le clergé séculier est présent sur tout le continent et il n’existe quasiment plus de communautés sans paroisses et dépourvues de prêtres.
A l’aube du Completionem, le clergé séculier n’est autre que les premiers prédicateurs de la foi complétioniste, en d’autres termes ceux qui ont propagé la parole de Prospertia et de ses prophètes à ses débuts. Relativement désorganisées et sans autorité suprême, les premières paroisses virent le jour sur l’initiative d’hommes de foi audacieux cherchant à conquérir les coeurs des populations, souvent sceptiques et parfois même réticentes à l’idée de laisser entrer dans leur vie une nouvelle spiritualité, un nouveau rapport au monde.
Cette dynamique de diffusion de la foi explique le caractère très hétérogène de la spiritualité sur le continent : en effet, les prédicateurs ont transformé leur message et leur discours en fonction des populations qu’ils rencontraient, adaptant la spiritualité aux besoins locaux. C’est ainsi que l’on vit se développer des cultes liés à la terre et la nature dans des paroisses au caractère rural prédominant. La foi complétioniste change sa peau en fonction de son environnement immédiat : des populations insulaires célèbrent des rites intimement liés à la mer, tandis que des populations urbaines continental développeront une ritualité célébrant l’artisanat et les arts. Néanmoins, si les pratiques diffèrent, les dogmes fondateurs ne sont pas remis en question : le mythe autour de la rencontre entre l’homme et Prospertia, de même que les expériences prophétiques sont transmises d'une seule voix par tous les membres du clergé.
En outre, si la pratique de la foi est hétérogène, il en va de même pour des autorités du clergé séculier qui sont éminemment décentralisées. Bien qu’il soit reconnu comme premier représentant de la parole divine sur terre, le lien de subordination entre le Dominus Patrem et son clergé séculier n’est pas toujours évident. Cela s’explique par un certain chauvinisme de la part des chefs de paroisse - ainsi que de leurs croyants - très attachés à leurs coutumes et pratiques locales. Le Dominus Patrem doit jongler avec cette sensibilité particulariste revêche au sein du clergé séculier lorsqu’il tranche sur un point de théologie ou de spiritualité. Les paroisses en Terre Sacrée font exception à la règle et lui sont extrêmement fidèles vue la proximité de Farhas, la politique d’uniformisation de la foi menée par la faction des canonistes et la relative homogénéité du territoire.
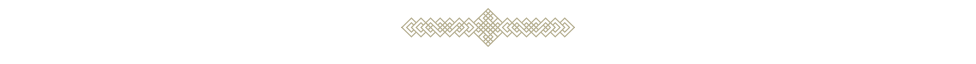
¶ Les Archiprêtres
L’archiprêtre - parfois nommé père supérieur ou prêtre supérieur - est le chef d’une paroisse, et la dirige à ce titre souverainement. Une paroisse comprend l’ensemble des églises, chapelles soumises à l’autorité de l’archiprêtre, ainsi que l’ensemble de la communauté des croyants vivant sur son territoire.
C’est un concile qui élit parmi ses membres l’archiprêtre, lorsque son siège est laissé vacant suite à son trépas ou sa résignation. Les conciles de paroisses ont des relents de gérontocratie puisque souvent composés des plus anciens prêtres, mais également du seigneur local, comme un comte par exemple. Paradoxalement, si les membres d’un concile sont relativement âgés, ils tendent par habitude à élire un archiprêtre assez jeune. L’élection d’un archiprêtre se fait rarement à l’encontre de l’avis du seigneur et peut faire l’objet de négociations. On observe une tradition pérenne où le plus souvent les sièges d’archiprêtres sont vacants suite à une résignation, plutôt qu’à un décès. En effet, il est vu comme vertueux pour un archiprêtre atteignant un âge vénérable de se retirer de son siège alors que la vieillesse pourrait le prévenir d’accomplir son devoir envers ses pairs et la communauté des croyants. Contrairement à un seigneur temporel, l'archiprêtre ne gouverne pas en son nom, mais est l'émanation du concile qu'il représente. Un archiprêtre qui perd l'assentiment de ses pairs du concile de la paroisse n'a plus de pouvoir et risque de se retrouver contraint de quitter son siège.
L’archiprêtre agit comme un petit seigneur en son domaine, les paroisses détenant souvent des terres qui leur ont été données ou prêtées par d’autres seigneurs voire dans de rares cas obtenues par héritage. Il détient aussi le pouvoir de juger les croyants et de rendre des sanctions sur des affaires de foi. Il peut aussi juger des affaires courantes sur les terres qui sont celles de la paroisse, organiser son économie, asseoir et prélever l’impôt, nommer des administrateurs et des représentants de son autorité ou encore entretenir une force armée. Tous les archiprêtres n’ont pas la même importance, selon la taille et l’envergure de leur paroisse.
Le pouvoir temporel entretient un lien étroit avec le pouvoir spirituel : le seigneur local participe au concile, l’archiprêtre célèbre la cérémonie d’intronisation du seigneur, les troupes de la paroisse font partie du ban de leur suzerain et le seigneur octroie un droit d’exploitation sur certaines de ses terres à la paroisse. En résumé, l’archiprêtre légitime le pouvoir du seigneur et le seigneur donne à la paroisse les moyens d’exister ainsi que d’assurer la pérennité de la foi.
Nota bene: Il est impossible de jouer un archiprêtre.
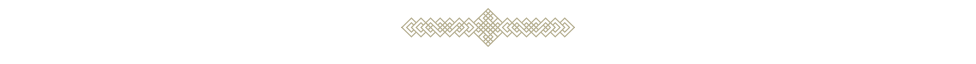
¶ Les Prêtres
Les prêtres sont la colonne vertébrale du clergé séculier et sont les clercs les plus nombreux au sein du Completionem. Ils sont reconnaissables à leur bure noire et leur coiffe nommée barrette. Ils célèbrent les offices religieux, bénissent les croyants, participent à la résolution de litiges et attestent de l’engagement pris sur certains actes entre deux parties : la vente d’un bien ou encore une promesse de fiançailles.
Avant d’être ordonné, les novices sont formés auprès de prêtres-enseignants ou révérends, ayant une longue expérience et plusieurs années au service de leur paroisse. Les novices doivent impérativement avoir reçu la Première Onction et avoir été reconnus aptes par de petits conseils paroissiaux réunissant quelques clercs. La formation diffère d’un territoire à l’autre, étant donné que la ritualité change selon son environnement, tous les novices ne reçoivent pas la même éducation. Il n’y a pas d’écoles de formation des prêtres, c’est ce qui explique en partie la désunion des pratiques spirituelles. Cela entretient bien évidemment les particularismes locaux et empêche la naissance d’une doctrine unique de l'exercice de la Foi.
Pour être ordonné prêtre, les novices doivent choisir de prononcer un voeu de leur choix : cela peut-être un vœu de chasteté, un vœu d’obéissance, un vœu de charité, un vœu de pauvreté ou bien d’autres. Le prêtre est ordonné par l’archiprêtre de sa paroisse et c’est ce dernier qui valide son vœu. Un prêtre est attaché à sa paroisse et ne peut en aucun cas la quitter, sauf permission accordée par son père supérieur. Lorsqu’il quitte le territoire de sa paroisse, il obtient un statut de missionnaire et reste sous l’autorité de son père supérieur : il ne saurait être jugé par un seigneur temporel.
Les prêtres participent à différents degrés à l’exercice du pouvoir aux côtés de seigneurs temporels locaux : conseillers, précepteurs, intendants, il est fréquent d’en croiser dans les couloirs des châteaux. La nomination d’un clerc auprès de la cour ou à la cour d’un seigneur est un gage d’amitié entre la paroisse et les autorités temporelles et concourt à cette puissante intrication entre religion et politique.