¶ Réduction osseuse :
La réduction osseuse désigne toutes les techniques destinées à recomposer l'intégrité d'un os fracturé. Celles-ci diffèrent selon la gravité et la nature de la fracture.
¶ Attelles et Bandages
Dans les situations simples de fractures non déplacées ni ouvertes, la pose d'une attelle bandée suffira à permettre une réduction naturelle de l'os dans une position physiologique. Cette technique d'immobilisation rudimentaire n'est toutefois compatible qu'avec les blessures les plus légères.
¶ Plaques et Clous
Dans les situations plus complexes, le chirurgien doit jouer d'ingéniosité pour recomposer l'os brisé et permettre sa réduction. Cela se fait au moyen de clous ou de plaques en argent ou en or (métaux non oxydables) fixés à même les os et fournissant un outil fiable pour leur immobilisation. Ces opérations lourdes supposent la préparation rigoureuse du patient et l'intervention d'artisans minutieux dans la création sur mesures de ces pièces.
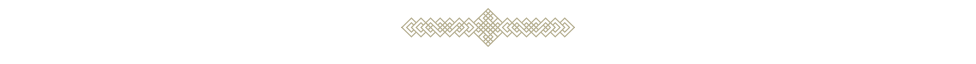
¶ Prothèses et Orthèses
Un chirurgien peut être amené à remplacer un membre perdu ou à aider un patient à suppléer à l'absence d'une fonction motrice. Pour ce faire, il doit être capable de concevoir des prothèses et orthèses aux mesures de ses patients.
Celles-ci demeurent rudimentaire et ne peuvent en aucun cas permettre de reproduire un mouvement naturel dans sa force et sa fluidité. Les plus évoluées de ces pièces misent sur un esthétisme accru en faisant intervenir des artisans talentueux dans leur confection.
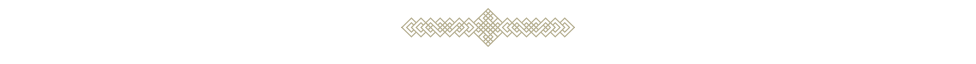
¶ Amputations
L'amputation est une intervention chirurgicale drastique pratiquée en dernier recours pour sauver la vie d'un patient face à une gangrène, une infection incontrôlable ou une blessure grave. Réalisée avec ou sans anesthésie, elle doit toutefois être précédée par une préparation prophylactique rigoureuse.
L'opération consiste à couper le membre affecté à l'aide de couteaux ou de scies, avant de cautériser la plaie ou de verser du goudron bouillant pour limiter les hémorragies et prévenir les infections. Bien que douloureuse et risquée, l'amputation était parfois suivie de la confection d'une prothèse rudimentaire en bois ou en métal, permettant au patient de conserver une certaine mobilité.
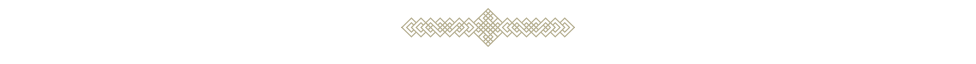
¶ Contrôle des hémorragies :
Le contrôle des hémorragies fait partie intégrante de la chirurgie générale, la célérité dans la pratique de ces gestes peut sauver une vie comme en condamner une autre.
¶ Sutures
La suture désigne l'action de refermer une plaie ouverte en utilisant des fils pour favoriser une bonne cicatrisation. Les matériaux employés sont variés, ils dépendent de la zone à suturer notamment : les fils peuvent être de soie, de lin ou de tendons d'animaux portés à ébullition.
Elles nécessitent une bonne antisepsie et une surveillance régulière du patient en cours de cicatrisation pour ne pas créer d'infection.
¶ Ligatures
La ligature est une technique visant à contrôler les hémorragies en nouant un fil autour des vaisseaux sanguins pour arrêter le flux sanguin, remplaçant ainsi la cautérisation au fer rouge, douloureuse et souvent inefficace. Les fils utilisés sont les même que ceux employés pour la suture. Bien que la ligature réduit les risques immédiats de saignements mortels, l’absence d’asepsie peut exposer les patients à des infections post-opératoires, elle nécessite également une pratique sûre et leste.
¶ Cautérisation
La cautérisation consiste à appliquer sur la plaie un métal chauffé au rouge ou, dans certains cas, des substances corrosives telles que les sels d'argent pour brûler les tissus. Bien qu’extrêmement douloureuse, elle est souvent pratiquée sans anesthésie du fait de la célérité qu'elle suppose.